| Conférence - Consensus La Wallonie au Futur Namur - 1994 Où en est
et où va |
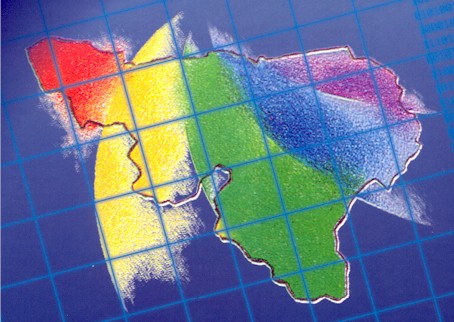 |
Synthèse des exposés
|
| Conférence - Consensus La Wallonie au Futur Namur - 1994 Où en est
et où va |
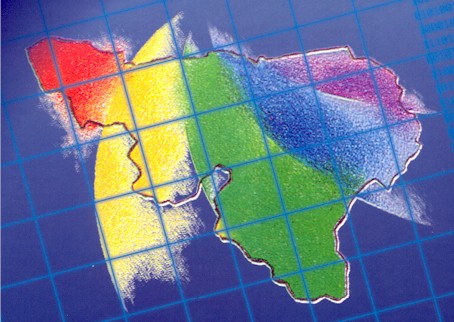 |
Synthèse des exposés
|
Ce matin, quand nous avons commencé, nous avons d'abord entendu un cri, un cri et une colère : Gilbert de Landsheere qui nous a dit : il y a quelque chose à faire. et il nous a envoyé un message : On a des instruments pour le faire et on a intérêt à faire usage de ces instruments. Puis, très vite, il a désigné quelqu'un qui se trouvait plus dans la pratique pour développer ces thèmes : il a préféré donner la parole à un autre qui donnerait un exemple nous montrant comment un pilotage scolaire peut fonctionner.
C'est Claude Thélot qui est alors monté à la barre pour nous parler de ce qu'on faisait en France. Ce qui m'a frappé dans son exposé, c'est qu'il ne voulait pas se limiter à une logique classique de récolte d'informations sur le système scolaire en vue de décisions. En effet, dans un tel but, il suffirait de faire des recherches par sondage. Au delà de telles enquêtes, sa pratique vise une action de transformation à travers et grâce aux recherches. On se trouve donc devant une perspective d'action. C'est d'ailleurs ce qu'annonçait Monsieur de Landsheere. Le but de Claude Thélot est de rendre possible un débat public sur chaque point litigieux du système éducatif, en provoquant des questions venant d'un peu partout. L'image de tous les enseignants recevant un questionnaire et devant travailler avec lui indique évidemment que cela implique une certaine participation de chacun. Le tout, de manière à pouvoir provoquer un débat public, au niveau de toute la société, mais aussi à l’échelon local. Cela fait écho à la notion de macro-pilotage et de micro-pilotage qui nous avait été signalée plus tôt. Ce processus vise une culture de l'évaluation dans laquelle on tâcherait qu'il y ait un peu moins d'évaluation par simple rumeur ou bien par l’évocation de faits divers.
Ensuite, André Krupa a continué dans la même direction en indiquant que, pour lui, évaluer, c'est créer un phénomène culturel et un état d'esprit qui permettraient de modifier un certain nombre de composantes du système de l'enseignement. Il a cependant aussi attiré notre attention sur le fait que, lors d'une expérience pilote - pour prendre un exemple particulier - lorsqu’une équipe de chercheurs avaient quitté le terrain, toutes les choses étaient revenues "dans l'ordre" (c’est-à-dire dans la situation d’avant l’intervention). Cela pose une question importante sur l'efficacité de cette expérience et sur le problème de l'articulation avec un suivi à long terme. Il a aussi signalé, par exemple, l'échec du Conseil de l'Enseignement et de la Formation dans la réalisation d'une des missions, à savoir l’établissement d’un rapport annuel sur l'état de l'enseignement ou de la formation en Belgique. Il semble que cela passe "au bleu" des profits et pertes de cette institution, ce qui est peut-être utile à noter comme trait institutionnel de notre situation en Wallonie.
Ensuite, Jean Magy a abordé ces questions au niveau institutionnel, par le point de vue d'un fonctionnaire - dans le sens le plus noble du terme - qui, sur le terrain, tâche de faire fonctionner une administration malgré des changements de ministres assez fréquents. Il a insisté - et il est intéressant de l'entendre quand on fait référence à l'après-midi - sur l'importance d'avoir un consensus sur des objectifs. Il a pris aussi du temps pour parler de la difficulté de la mission de l'inspection et de l'importance d'avoir un corps d'inspecteurs qui puisse faire fonctionner efficacement un certain type de pilotage à un moment donné, dans le concret. Il s’est demandé aussi comment on pourrait créer un réseau de services d'animation qui puisse, dans le détail de toutes les écoles, faire quelque chose qui se rapproche de la notion de micro-pilotage.
Cela nous conduit, en fin de la matinée, à une série de questions pour entamer l'après-midi qui, elle, va entrer en une sorte de collision dialectique avec la première partie de la journée.
En effet, l'après-midi, il y a d'abord l'exposé de Bernard Delvaux qui nous montre, avec beaucoup de petits points de détails à l'appui, la complexité du problème. On se rend compte qu'effectivement, comme il le dit, on a beaucoup de statistiques mais peu d'informations - c'est à dire peu d'éléments qui soient replacés dans un contexte tel qu'ils puissent vraiment faire sens. Il fait remarquer comment, très souvent, les informations qui sont recueillies sont marquées par une culture de l'efficacité, liée à l'image d’un décideur qui, ayant toutes les informations, va pouvoir finalement faire le meilleur choix. Il nous met en garde vis-à-vis de cela. Il met en garde aussi par rapport à l'image fallacieuse d'une information qui serait disséminée partout mais qui, finalement, isolerait chacun des acteurs de sorte que chacun agirait dans une perspective néolibérale qui, sous prétexte de transparence, serait en fin de compte bien peu transparente : la masse d'informations parcellisées serait finalement équivalente à pas d'information du tout. Il a terminé en s’interrogeant sur la capacité d'avoir un débat public efficace. Et, à ce sujet, il a suggéré l’intérêt d’un niveau intermédiaire entre les grosses institutions de la région, d'une part, et les établissements, d’autre part : le lieu de la zone. Il a pointé par là un problème souligné par beaucoup de sociologues : celui de l'absence d'institutions au niveau mezzo, comme on dit : entre les deux. Il y a peut-être là une série de choses à faire car on peut constater une tendance à renvoyer soit à des instances très centralisées, soit à prétendre que tout va être décentralisé. Ne pourrait-on valoriser un niveau intermédiaire ?
Ensuite viennent les inter... - j'allais dire les interruptions - des autres sociologues. Le lapsus me paraît très significatif puisque, de même que la matinée avait commencé par un cri, j'ai l'impression que nous avons entendu un autre un cri, par après. Ce cri est celui des sociologues. On pourrait résumer leur intervention en un avertissement : "Mais, enfin, rendez-vous compte qu'il est bien possible, que, à travers tout cela se réalisent des choses bien différentes de ce que l'on veut ou avait prétendu faire."
D'abord, Jean-Emile Charlier fait remarquer que, si on peut récolter beaucoup d'informations, la notion de pilotage paraît plus difficile à manier. En effet, dit-il, il est impossible - si je résume bien, parce que c'était assez dense - il est impossible de s'accorder sur des objectifs opérationnels. Effectivement, quand on regarde les grands objectifs du Conseil de l'Education et de la Formation, par exemple, (j'ajoute ici une note personnelle car j'en ai fait l'analyse et j'ai exactement la même impression que lui) on se rend compte que tous les problèmes difficiles ont été évités, et que c’est uniquement grâce à cela qu’on a obtenu un consensus. Je ne dis pas que ce consensus n'était pas intéressant et je crois même qu'il l'était. N'empêche qu'apparaît ici la difficulté de s'accorder sur des objectifs opérationnels et - peut-être plus encore - de l'impossibilité de les imposer. D'où son appel à un réalisme socio-politique : on ne manque pas tellement de moyens pour travailler dans l'enseignement, mais on manque d'une définition de priorités. Et les appels à des instruments techniques ne masquent-ils pas, à certains moments, un manque de souffle dans la société et une difficulté à définir des objectifs socio-politiques qui permettraient un certain rassemblement ? Je ne crois pas qu’il voulait parler ici d’un consensus, mais bien d’un certain rassemblement autour de compromis qui pourraient être viables.
Dans la même ligne, Anne Van Haecht souligne le contexte politique dans lequel ces questions se posent. Elle fait remarquer comment, en Angleterre - et ce n'est peut-être pas par hasard - c'est au moment du gouvernement Tatcher qu’on a fait appel à toute une série de méthodes de pilotage. Elle demande une démarche pluraliste par laquelle, dans la société, on puisse travailler ensemble à tâcher de définir des objectifs, à chercher des lieux de négociation, le tout de manière à éviter qu’une rhétorique tournant autour de la décentralisation ne conduise finalement à une gestion néolibérale. Dans celle-ci il n’y aurait de place que pour une pure négociation de marché (ou de quasi-marché) qui réglerait l'ensemble de la question. Finalement, elle fait un appel à la mémoire et à l’histoire : vis-à-vis de toutes ces questions éducatives, il y a une dimension historique dont il faut tenir compte : nous ne venons pas de nulle part, mais d'un passé précis. et, en même temps, il faut considérer les rapports de force et les intérêts en jeu. Tout cela se négocie et ne peut se penser de la même manière que la gestion d'une centrale électrique (cette expression vient de moi et non d’elle).
De toutes ces considérations, manifestement, nous sentons le choc parmi nous, ce soir : dans mes notes à propos du débat de cet après-midi, j’ai écrit qu'on voit apparaître dans la salle un sentiment - qui est très fréquent dans notre société - : le sentiment d'impuissance. Face aux contradictions entre les experts, j’ai l’impression de percevoir d’une part une demande de solution, et d’autre part, l’expression de ce que la complexité des problèmes laisse un peu pantois. Devant cette situation, je m’interroge sur ce que j'appelle l'idéologie de l'impuissance : ce discours est fréquent dans notre société au sein de laquelle les choses sont tellement complexes qu'on estime ne rien pouvoir faire. Finalement cette idéologie de l’impuissance aboutit à des impasses. à partir du moment où on se ressent comme impuissant, les choses sont très difficiles à gérer. C’est ainsi que, suite aux échanges de cet après-midi, un certain nombre de réactions ont voulu réaffirmer que le discours critique - nécessaire, je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus†- prend son sens dans la mesure où il n’engendre pas l'impuissance, mais désigne des lieux où l'on peut agir avec une certaine lucidité et avec un certain courage politique. Dit autrement : il y a une série d'effets pervers dans tout ce que l'on fait, mais les seuls qui n'ont pas les mains sales, ce sont ceux qui ne font rien. Par conséquent, il s'agit de s'engager quelque part - et je crois d'ailleurs que c'était le message de nos sociologues - même si, dans la pratique de leur discipline, ils étaient restés à un certain niveau académique du message, laissant au reste de l'assemblée le soin de tirer les conclusions et d’admettre que les mains doivent se salir dans l'action, dans les enjeux qui sont présents.
Ensuite, Christine Mainguet, calmement, nous expose un certain nombre de choses qui se font, présentant des éléments précis et des indicateurs qui, dit-elle, doivent faire sens pour éviter que, comme le disait Claude Thélot ce matin, l'enseignement ne se gère autour de rumeurs. Elle montre comment on peut avoir une production d'informations qui puisse servir.
J'en arrive ainsi au bout du reflet des communications de ce jour. C'est le moment où je vais dire une parole encore un peu moins neutre que mon rapport (qui était évidemment un peu biaisé).
Quand j'entends tout cela, je me rends compte qu'il y a un mot que nous n'avons pas encore prononcé jusque maintenant - ou très peu - : c'est le mot institution (même si les questions institutionnelles étaient sous-jacentes à bien des exposés de la journée). La question qui me paraît importante en ce moment-ci, c'est de se dire que, face aux questions que nous avons rencontrées, il est peut-être important de tâcher de nous donner ce qu'un chercheur américain qui s'appelle Robert Bellah appelle de bonnes institutions. Attention ! : le mot bonnes est évidemment ambigu. Mais, acceptant l'ambiguïté, j’appelle "bonnes" des institutions qui nous permettent de travailler. Il est clair que nous ne serons jamais parfaits, ni nous, ni nos institutions, mais je crois que, si l'on veut se donner des "mains" dans la société, il faut se donner des institutions. Elles seront toujours ambiguës; elles seront toujours des lieux de conflit; mais, cependant, il faut nous en donner. Et d’ailleurs, refuser de s'en donner, c'est finalement faire l'option de l’institution pure du marché où les rapports de force ne sont plus médiatisés par une discussion grâce à laquelle on peut négocier un peu plus ce que l'on veut.
Quand je regarde ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai l'impression - et maintenant je parle vraiment en mon nom personnel - que, ce qu'on nous demande, c'est de tâcher de créer certaines institutions qui puissent induire un débat public sur le système éducatif, de manière à ce que le débat ne se fasse pas dans les ombres d'un cabinet ministériel ou d'une administration, ou d'un Conseil de l'Education et de la Formation qui publie très peu ce qu'il produit (même si je crois, comme d'autres, qu'il produit parfois des choses fort intéressantes). Nous désirons qu’il y ait des institutions qui produisent un débat public - cela, j'ai l'impression de l'avoir entendu de divers côtés -, et que ce débat soit à la fois technique et socio-politique.
Je crois que quelque chose ne marche pas quand on oppose ces deux dimensions : le politique et le technique. Quand, pour valoriser le caractère politique des débats sur l’éducation, on veut court-circuiter la dimension technique des problèmes, on induit finalement le contraire de ce que l'on veut car finalement le "technique" (c’est-à-dire une épaisseur de la réalité) se vengera. Le technique est un des lieux où on peut se confronter aux choses, c’est-à-dire avec des tiers-objets qui font éclater le face à face des individus. Il n’y a pas que des négociations entre personnes "pures" : toutes les négociations politiques se font dans un monde de choses, d’institutions et de contraintes qu’il faut pouvoir se représenter. Il y a ainsi une dimension technique qui me paraît absolument incontournable. Mais en même temps, le but de l’acceptation de cette dimension technique me paraît devoir être la confrontation d'intérêts variés, de valeurs qui ne se recouvrent pas - même si certains mini-consensus peuvent être obtenus ci et là. Il faut donc en arriver à ce que la confrontation puisse déboucher sur un débat socio-politique intégrant des éléments techniques - en se rendant compte cependant qu’aucun de ces éléments techniques n'est complètement neutre. Comment trouver de telles institutions qui induisent un tel débat public ? C'est un premier point qui me paraît important; j'y reviendrai d'ailleurs.
Un second point qui me paraît important, c'est que j'ai l'impression d'avoir entendu pendant cette journée une question de société qui pourrait s’énoncer comme suit : Comment pouvons-nous négocier le développement des sciences de l'éducation ?
Je crois que, il y a une trentaine d'années, les sciences de l'éducation étaient dans l'enfance. Aujourd'hui, je pense qu'elles sont incontournables. Evidemment j'ajouterai - rappelez-vous que je suis proche de la physique, une vieille discipline, comme profession centrale - que les sciences de l’éducation vivent leur " maladie d'enfance " de toute jeune discipline, c'est-à-dire de se croire un peu trop absolue et de prétendre pouvoir tout résoudre. Mais cela étant dit, je les crois incontournables.
Nous avons ainsi un problème de société, qui est de voir comment négocier le développement des sciences de l'Education. Ca voudrait peut-être dire que, au niveau de nos Universités et de nos Ecoles normales, il y aurait à se doter d'un peu plus de réflexion critique par rapport à ces sciences de l'Education. Non pas pour les brimer, mais au contraire, pour mieux déterminer leur lieu d'impact central afin que, finalement, elles puissent réellement apporter quelque chose. Cette négociation avec de nouvelles technologies intellectuelles me paraît un des problèmes de notre société. A ce sujet, je pense que ce qu'on a entendu avec l'exemple français nous indique un certain nombre de directions intéressantes.
J'en indiquerai d'autres. Par exemple, celles qui se construisent dans les pays du Nord autour de ce qu'on appelle le Constructive Technology Assessment, c’est-à-dire une certaine manière de travailler avec le développement des technologies pour tenter de les construire avec un peu moins d'effets pervers.
Donc, premier point : débat public, technique et socio-politique. Deuxième point : négocier le développement des sciences de l'éducation dans notre société. Le troisième point, j'ai l'impression de l'avoir entendu un bon nombre de fois : l'appel à une culture d'évaluation, c’est-à-dire d'abord une culture où l'on se pose des questions à propos de ce que l'on a fait.
Et puis, j'ai entendu aussi d'autres voix à propos de la culture, qui réclamait une culture politique. On s'est rendu compte que l'évaluation ne se situe pas dans un monde abstrait d'idées, mais dans des négociations au milieu de rapport de force.
Et puis j'ai aussi eu l'impression d'entendre un appel à ce que je serais tenté d'appeler une culture tout court, c'est-à-dire, une capacité de poser des projets et de voir l'avenir avec une certaine représentation de ce qu'on pourrait y réaliser et faire. J'ai l'impression d'avoir entendu un appel pour qu'une certaine culture de ce type-là soit créée.
De là découle la question suivante : par quelle institution ? A ce propos, il me semble que nous avons moins de réponses au cours de notre journée.
Quand j'observe notre journée, je me dis d'ailleurs qu'un exposé nous manquait, celui d’un sociologue d'institutions qui aurait parlé de certains choix institutionnels - de manière pas trop technocratique si possible, mais cependant suffisamment technique -.
Enfin, une question, qui me semble être revenue plusieurs fois aussi, concerne l'interaction entre le politique et l'économique. Nous sommes en train de vouloir faire toute une série de choses en une période où on veut aussi faire des économies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas été complètement satisfait de tous les exposés de ce point de vue là, et je voudrais y ajouter un élément. En cette période où l'on fait des économies, il y a deux types d'attitudes possible : une attitude critique qui a 100 % raison et qui montre que, derrière toutes les réformes proposées actuellement, il y a effectivement une manière de vouloir gagner de l'argent. Sous un certain point de vue, cela me paraît indéniable et pourtant... finalement mortifère par sa négativité. Pourquoi ? Parce que je crois que ceux qui réalisent un monde sont ceux qui, au moment où une série de contraintes obligent à faire des choix, donnent les coups de barre comme ils le peuvent dans le monde réel, et non dans un monde imaginaire où l’on pourrait faire tout comme on le veut. Dans ce contexte - je deviens de plus en plus personnel - je vous dirai comment j'en ai ras le bol d'entendre les gens dire que telle ou telle mesure s’est faite pour des raisons économiques. Je crois que c'est en partie vrai, mais ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir si telle ou telle mesure peut avoir un certain nombre d'effets intéressants. Parce que, des mesures, on en prendra. Ce ne sont donc pas les cris de ceux qui disent qu’elles visent l’économie de gros sous qui changeront finalement les choses. Ceux qui, je crois, changeront le monde, ce sont ceux qui, dans cette situation-là, donneront des coups de barre et feront se diriger effectivement le navire plus dans une direction que dans une autre. N'essayons pas de dire qu'on aura les mains propres là-dedans : je crois qu'on les aura sales.
Quand on dit que tout, à propos du système d'enseignement, peut se traduire en terme de gros sous, ne succombe-t-on pas à l'idéologie de l'économicisme : celle qui ramène tout à l’économique ? Cette idéologie ne doit en effet pas seulement être dénoncée de manière globale, comme lorsqu’on accuse notre société de ne pas donner à l’enseignement une priorité sur l’économique (même s’il y a un problème à ce sujet, et qu’il faudrait en faire l’étude politique). Refuser l’économicisme, c’est aussi envisager l’enseignement d’un autre point de vue que celui de son coût. Par exemple, comme un problème culturel à résoudre. Ce qu'on a dit à certains moments était très typique de ce point de vue : retrouver des sources de choses intéressantes à faire. Je crois donc que, à travers les changements qui s'opèrent, il s’agit de tâcher de trouver un chemin créatif.
Et je le répète : pour moi le problème le plus central n'est pas au niveau de l’économie, mais bien des institutions. Il nous faut trouver comment, soit créer des institutions qui en valent la peine, soit utiliser au mieux celles qui existent. Pensons, par exemple, au Conseil de l'Education et de la Formation : pourquoi ne pas demander que cette institution puisse servir d'Observatoire du système d'éducation belge, au lieu de se limiter à des débats socio-politiques sur ce qui se passe ? Pourquoi ne pas tâcher aussi, au moment où des choix doivent se faire, de réfléchir à la façon de créer des lieux de Recherche-Action qui ne se situeraient pas purement et simplement au niveau didactique, mais aussi au niveau politique†?
Enfin, il me semble que, à travers tous les mouvements durs que vit notre société, on peut désigner un autre lieu institutionnel capital dans les perspectives évoquées aujourd'hui : c'est celui de la formation des enseignants. Ils n'ont pas été formés à se situer, ni par rapport au développement des sciences de l'éducation, ni par rapport au développement des débats socio-politiques. Il y a encore un débat à faire pour qu'ils ne se sentent pas trop impuissants face à ce qui se passe, et surtout qu'ils ne transmettent pas une culture de l'impuissance aux jeunes générations.
Je me résume : j'ai proposé quatre directions. Primo, après avoir insisté sur les institutions, j’ai souhaité un débat public qui soit à la fois technique et socio-politique. Secundo, j’ai appelé de mes voeux une négociation du développement des sciences de l'éducation, ce qui demande une réflexion plus socio-politique à leur sujet. Ensuite, j’ai évoqué le développement d'une culture de l'évaluation, liée à une culture politique, c’est-à-dire d’une culture qui soit capable de faire et défendre des projets. Finalement, j'ai lancé un appel pour que l'on utilise les développements pénibles de notre crise économique et de notre société, pour tenter de faire des pas précis dans certains lieux institutionnels : j'en ai notamment cité trois, le Conseil de l'Education et de la Formation, le niveau de la Recherche-Action (aussi bien du point de vue de la pédagogie que de la politique de l'enseignement) et finalement le niveau de la formation des enseignants.
Merci.
(Mars 1994)
 |
Page mise à jour le 23-08-2004 |
|
|
|
||
|
Tous droits réservés © Institut Jules-Destrée |