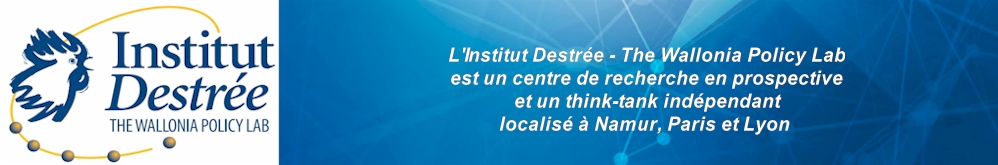Chômage et aménagement -
réduction du temps de travail
La méthode des scénarios
Jean Daems
Maître de Conférence à la
Faculté ouverte de Politique économique et sociale (FOPES),
Université catholique de Louvain
1. Limites
de formes actuelles de partage du travail
Une discussion sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail est plus que jamais à l'ordre
du jour.
Certes, nous savons que
le partage du travail est déjà une réalité. L'emploi à temps plein a diminué de
275.000 unités entre 1970 et 1994 (dans le régime des salariés). En postes de
travail, la perte n'est que de 103.000. Le partage du travail a donc permis le
maintien de 172.000 postes de travail. Il n'y a pas moins d'emplois, mais le
nombre de demandeurs d'emploi s'accroît considérablement et cet élargissement de
l'offre de travail n'est pas près de se tarir.
Personne dans cette
assemblée n'ignore plus
-
Que la croissance
économique à elle seule ne suffira plus (plus jamais ?) à résorber le
chômage.
-
Que les formes
actuelles de répartition du travail ne suffisent pas - loin s'en faut - à
résorber le chômage devenu massif mais aussi qu'elles sont très
inégalitaires. Il suffit pour s'en convaincre de voir la place qu'occupent
dans le chômage les travailleurs à scolarité faible (85%), les
femmes
(60%) et les travailleurs des régions en déclin.
La pré-pension qui
concerne plus de 200.000 personnes est une autre forme de partage, très coûteuse
pour la collectivité, non seulement par les moyens financiers mis en oeuvre,
mais aussi par la perte de savoir liée à cette sortie prématurée du marché du
travail.
La troisième mesure la
plus utilisée concerne le travail à temps partiel qui concerne 2% des
hommes au travail mais 25% des femmes dont la grande majorité n'a manifestement
pas choisi librement ce régime.
Danielle MEULDERS et
Robert PLASMAN nous fournissent régulièrement de précieux moyens de connaissance
de la manière dont le travail rémunéré se répartit.
Le dernier train de
mesures gouvernementales de début octobre est venu confirmer l'absence de
volonté politique d'inverser ces tendances profondément inégalitaires.
Les perspectives
d'avenir, à court terme du moins, sont donc sombres, très sombres.

2. Imaginer un avenir
différent
De nombreux sondages
d'opinion montrent cependant que parmi la population, le chômage s'impose de
plus en plus comme la préoccupation majeure des individus et des familles.
Proposons dès lors une
autre démarche, plus prospective, non pas avec l'ambition -dé- placée -
d'élaborer un paradigme alternatif au paradigme dominant fondé sur le marché
mais en vue d'élargir l'angle d'approche, d'introduire dans le débat ce que les
épistémo- logues américains appellent des "métaphores génératrices", qui
facilitent une compré- hension renouvelée du problème et surtout une perception
sans a priori des futurs possibles.
L'objet de cette
communication est, à partir des données connues, de proposer une vision plus
dynamique du jeu des interactions de certaines hypothèses en vue d'en faire
ressortir les incidences en matière d'emploi... et de temps libre.
2.1. La démarche
prospective
La démarche prospective
consiste à élaborer des scénarios, c'est-à-dire "des ensembles formés par la
description d'une situation future et du cheminement des événements qui
permettent de passer de la situation d'origine à la situation future" (GODET,
1983); Elle permet notamment d'évaluer les conséquences des diffé-rentes
stratégies d'action pouvant être élaborées par les acteurs en présence.
Notre intention étant
d'éclairer le champ des possibles en vue de l'action, nous ne retiendrons ici
que deux scénarios extrêmes qui diffèrent en fonction des arbitrages opérés au
niveau de la répartition du temps de travail, du partage des richesses et des
valeurs en jeu dans la société.
2.2. Le scénario gris et
le scénario rose
Le premier scénario ne
fait que prolonger les tendances lourdes repérées par l'analyse du système
actuel. C'est un scénario de type tendanciel.
Le deuxième, le scénario
rose (sans allusion) est un scénario normatif d'anticipation.
Entre ces deux hypothèses
peuvent s'insérer de multiples variantes selon les couleurs de l'arc-en-ciel.
2.2.1. Le scénario
gris ou la société duale atténuée
C'est le scénario le plus
évident, le plus probable si on continue comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on
multiplie les mesures partielles afin d'atténuer ou de masquer les grands
déséquilibres.
Le rapport entre actifs
et inactifs est le centre d'un tourbillon que les différents acteurs essaient de
contrôler en mettant en place des mesures stabilisatrices.
Les composantes du
tableau sont connues.
Le processus de
vieillissement de la population se poursuit sous l'effet de la baisse de la
fécondité et de la mortalité pour les plus âgés. Avec un solde migratoire
presque nul, les plus de soixante ans représentent 20% de la population totale.
La croissance économique
ne dépasse pas 2%. Elle permet tout juste de mettre en place quelques mesures de
non exclusion pour la masse importante des inactifs. Le recours accru au minimex
permet à une population flottante de ne pas sombrer dans la misère.
Le travail à temps
partiel, de plus en plus "encouragé", se développe considérable- ment.
Les instances politiques
des différents partis adoptent un profil bas et évitent les prises de position
trop tranchées. Il est rare que les élus des différents niveaux s'affrontent sur
des questions de société. L'image de la société se développe autour du confort
minimum et du noyau familial. Le local, le quartier, la commune jouent un rôle
de plus en plus grand dans l'intégration sociale.
A l'horizon de l'an
2000, cette recherche permanente d'équilibre ne favorise pas le dynamisme au
niveau économique. Les délocalisations d'entreprises de pointe commencent à se
multiplier.
Les déséquilibres
actifs/inactifs s'accentuent et la panoplie des mesures de traite- ment social
du non-emploi pèsent de plus en plus lourd dans les budgets publics.
Les jeunes, de plus en
plus attirés par des pays économiquement et culturellement plus vivants que la
Wallonie vont tenter leur chance ailleurs. Beaucoup reviennent, encore plus
désenchantés. La dégradation économique entraîne l'arrêt progressif des aides
aux sans-ressources. Les allocations sociales sont de plus en plus sélectives.
Les pensions elles-mêmes sont menacées entraînant un affaiblissement accéléré
des formes de solidarités traditionnelles.
Dans les différents
parlements, les débats politiques se durcissent. On assiste à la montée d'une
tendance politique conservatrice qui prône les vertus du libéralisme économique
pour les entreprises et l'austérité renforcée en matière de redistribution.
L'ombre du tatchérisme plane sur les débats. On se croirait revenu vingt ans en
arrière.
L'esprit d'équilibre
social qui imprègne les valeurs sociales et motive les actions, détermine les
politiques fédérale et régionales et celle des collectivités territoriales, y
compris en matière de culture. En effet, l'ensemble des politiques concernant la
jeunesse, l'éducation permanente, la culture et l'action sociale se confondent
dans des objectifs d'intégration sociale et de lutte contre l'exclusion.
La catégorie des
personnes travaillant dans des "petits boulots", composée de jeunes et d'adultes
de plus de 55 ans possède un capital "temps libre" très élevé. Ce temps inoccupé
permet à la plupart d'entre eux de s'investir dans des activités d'économie
parallèle qui est le seul secteur vraiment en croissance.
2.2.2. Le scénario
rose : la société solidaire
Ce scénario d'évolution
sociale est caractérisé par l'étalement des revenus sur l'ensemble de la vie des
individus, incluant les périodes de formation, de travail, de recherche d'emploi
et de retraite dans une logique de partage des ressources entre l'ensemble des
composantes de la société. Le travail y est réparti entre tous grâce à une
réduction générale du temps travaillé, permettant une augmentation sensible du
temps libre.
Ce scénario suppose une
reprise du rythme de croissance, des lueurs de conjoncture plus favorables sur
lesquelles les gouvernements s'appuieraient pour répondre aux attentes de la
société civile qui revendique une répartition des produits de cette croissance
comme en témoignent les nombreux conflits sociaux de la fin des années
quatre-ving-dix.
La concertation sociale a
repris vigueur. Le gouvernement réunit les interlocuteurs sociaux sur le
développement technologique et l'organisation du travail. Cette ini- tiative
aboutit à la mise au point d'un accord interprofessionnel qui préconise -en-
fin- que la modernisation de l'appareil productif ne se réduit pas à un renou-
vellement des machines mais passe par les hommes et leur travail, et par les
produits et leur marché. L'accord reconnaît que l'investissement technologique
n'est pas rentable si l'on ne fait pas évoluer parallèlement l'organsiation du
travail en la rendant qualifiante, ce qui entraîne un changement des rapports
sociaux internes à l'entreprise, donc aussi pour les syndicats l'abandon du
tabou des hiérarchies et des classifications.
En contrepartie, l'accord
permet aux organisations syndicales de faire redémarrer la question de la
réduction du temps de travail qui avait piétiné jusqu'au milieu des années
nonante.
Une réduction
significative de la durée du travail est considérée comme contrepartie aux
aménagements et à la flexibilité demandée par le patronat.
Cette politique présente
en outre trois avantages capitaux :
-
celui de permettre
une diminution massive du chômage par la réduction du temps de travail
individuel et l'allongement du temps de fonctionnement des équipements ;
-
la concertation
sociale est rétablie grâce à l'intérêt accru porté à la valorisation du
capital des hommes ;
-
ce projet correspond
à une aspiration forte et de plus en plus nette un peu partout en Europe,
l'aspiration à la qualité de la vie.
Plusieurs enquêtes
(CHARLIER, 1995) ont montré l'existence d'une demande sociale de temps en
croissance, demande orientée vers la sphère domestique et la vie familiale.
Le premier enjeu d'une
RDTT résiderait ainsi dans l'espoir d'une répartition plus égalitaire des
contraintes familiales.
Il ne suffit pas de
choisir de lutter contre le chômage massif par la réduction généralisée du temps
de travail. Il faut encore choisir la formule la plus adéquate.

3. Quel scénario de
réduction du temps de travail ?
La question du temps de
travail se situe à l'intersection de trois enjeux fondamentaux : l'efficacité
économique, les aspirations individuelles et sociales, l'emploi.
On peut chercher à
montrer l'articulation de ces trois enjeux qui correspondent aux trois niveaux :
micro, celui des individus, méso, celui des entreprises et le niveau macro qui
vise l'emploi et l'ensemble de la population active.
Si l'aménagement-réduction
du temps de travail semble bénéfique aux trois niveaux dans le scénario rose, ce
qu'ils en attendent diffère cependant sensiblement. Les entreprises souhaitent
plus de flexibilité, les individus aspirent à plus de temps libre tandis qu'au
niveau de la société, c'est l'effet positif sur l'emploi qui est attendu.
Celui-ci dépend de trois facteurs : l'ampleur de la réduction du temps de
travail pour avoir un effet partage positif, la hausse de la productivité qui a
un effet négatif et la variation de la compétitivité induite par la
réduction-aménagement du temps de travail.
Ce dernier effet sera
positif sur l'ARTT s'il n'entraîne pas de hausse des prix des biens et services
produits. Il dépend de la manière dont la réduction est financée. A ce sujet,
cinq éléments peuvent se combiner : l'entreprise, les travailleurs, la
productivité du travail, la productivité du capital et l'Etat.

4. Objectifs généraux
poursuivis
Il doit être clair que
tout projet d'ARTT qui vise à mettre plus de gens au travail ("à l'emploi")
repose sur des choix politiques qui sont autant de choix de société et servent
donc de critères pour évaluer tout projet et tout dispositif avancés pour lutter
contre le chômage.
-
Le droit et le
devoir, pour chacun, de participer à la citoyenneté en participant à la
société, c'est-à-dire
- un droit au revenu qui permette de vivre dans la dignité ;
- un droit à être et se sentir utile dans une société traversée par des
valeurs de solidarité. C'est pour nous la fonction du travail.
-
Vouloir l'emploi,
mais pas à n'importe quel prix. L'emploi doit être lié à un statut qui
intègre à la sécurité sociale et assure la dignité des personnes.
-
Aujourd'hui, toute
politique de l'emploi doit comprendre un objectif de lutte contre
l'exclusion sociale.
-
La politique de
l'emploi doit intégrer une volonté de lutte pour l'égalité des chances et
l'équité.

Tableau Synthèse
Formule de RDTT |
Point de vue indiv. de famille |
Entreprise |
Emploi |
Financement par |
- |
- |
- |
- |
Entreprises |
Travailleurs |
Hausse productivité du travail |
Hausse productivité du capital |
Etat |
Durée quotidienne |
Le temps libéré affecté à la spère familiale |
OK si permet un changement de la durée d'utilisation des équipements - si
l'entreprise fait face à des heures de pointe (distribution et restaurant
par ex.) |
Effets positifs si pas de dégradation de la compétitivité (pas de hausse de
prix des biens et services produits) |
Possible dans la mesure où permet d'éviter de coûteux licenciements |
Oui, si les horaires sont adaptès aux besoins du travailleur et non de
l'entreprise |
Via diminution de la porosité de la journée et de la fatigue des
travailleurs |
Oui, si production est réorganisée (horaires plus inconfortables pour les
travailleurs ?) |
L'Etat a déjà financé ce type de RDTT (subvention du travail à temps
partiel) |
Durée hebdomadaire (4 jours) |
Temps et coûts de déplacements réduits de 20% - baisse les coûts de garde
d'enfants de 20% ou de 40% si parents choisissent jours libres différents -
ouverture plus grande à projets de temps libre : forte demande |
Permet d'allonger l'utilisation équipements (compensation salariale ?) |
- |
Idem que durée quotidienne |
Idem que durée quotidienne |
Obtenue via la diminution de la fatigue des travailleurs suite notamment à
la diminution du temps de transport |
idem que durée quotidienne |
Idem que durée quotidienne. Nécessité d'incitants (indiv. et entrepr.) |
|
Formule de RDTT |
Point de vue indiv. de famille |
Entreprise |
Emploi |
Financement par |
- |
- |
- |
- |
Entreprises
|
Travailleurs |
Hausse productivité du travail |
Hausse productivité du capital |
Etat |
Durée annuelle (allonger les congés) |
Meilleure gestion du temps sur l'année (peu de demande) |
Annualisation du temps de travail |
- |
Possible si variations saisonnières de la production |
Si correspond aux souhaits du travailleur |
- si le congé est consacré à la formation - moins de fatigue des
travailleurs |
L'allongemnt de la durée d'utilisation du capital (compensée par congés) |
- |
Carrière (Crédit- temps) |
Crédit temps : permet au travailleur de gérer sa carrière professionnelle en
fonction de ses besoins de temps et projets. Responsabilise l'individu par
rapport à sa vie |
Exige forte planification collective |
- |
Les entreprises financent déjà les prépensions. Idem que durée quotidienne
et durée hebdomadaire |
Oui (mais peu connu) |
Evidente dans le cas d'un congé sabbatique. Plus grande motivation des
travailleurs |
Idem que durée annuelle + implique un lien à long terme entre l'entreprise
et l'employé |
Serait financé comme les prépensions et les pauses - carrières + congé
éducation |
Références
CHARLIER J.M. et alii (1995) Le temps de travail et son aménagement, par
Charlier J.M., Daems, J., Meulders D., Plasman R., Vander Stricht V., Fondation
Roi Baudouin, Programme Prospective Sociétale, Bruxelles
de JOUVENEL H. et alii (1990) Le temps et rien d'autre, La documentation
française, Paris
GODET M. (1983) La méthode des scénarios, in Futuribles n 71
GODET M. (1988) Prospective et planification stratégique, CPE, Economica, Paris
HOFFMANN R. et LAPEYRE J., (1995) Le temps de travail en Europe, organisation et
réduction, Paris, Syros

|