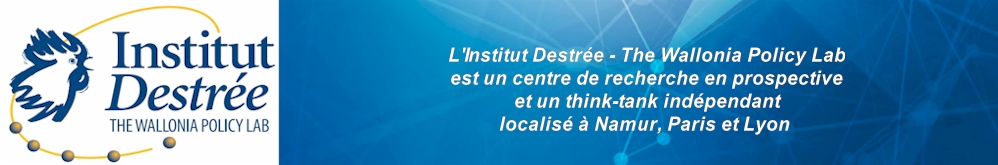|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : enquête force de travail 1988 INS. D'autre part,En automne 1990, il reste 211 places disponibles dans les crèches et 2.108 demandes insatisfaites. Dans quatre régions sur six, le délai d'inscription dépasse les neuf mois et atteint parfois 18 mois! (faudra-t-il s'inscrire avant d'être enceinte?). La situation est particulièrement critique à Bruxelles et dans le Brabant Wallon. Indépendamment du nombre de places, les refus sont dus aussi à une incompatibilité d'horaire entre les parents et les institutions. Nombre de places subventionnées en 1988
Source : Combat du 25.06.90. Le budget de l'Oeuvre de la Naissance et de l'Enfance (ONE) représente 1,7 % du budget de la Communauté française et les subsides aux modes de garde sont de 0,9 % de ce même budget. Il est clair qu'il n'y a pas de politique globale de la petite enfance francophone. Arguer de restrictions budgétaires dans ce domaine est plus qu'inadéquat quand on sait :
Il importe donc d'établir des passerelles financières de solidarité, de remodeler les attributions des organes d'obédience communautaire, régionale et nationale dans le sens d'une complémentarité financière harmonieuse, seule susceptible de mener une vraie politique globale de l'enfance. Ces constats évidents caractérisent clairement l'évolution de notre société et amènent à revendiquer des ajustements prioritaires pour le devenir de la Wallonie en particulier.
Les équipements collectifs 1. Boulot - Bébé - DodoLa place des femmes sur le marché du travail est un phénomène irréversible et l'harmonisation des responsabilités familiales et professionnelles prend un caractère urgent. Un sondage récent de la SOFRES pour l'émission "La Marche du siècle" à FR3 est des plus convaincant. Il est certain que si Paris tousse, Bruxelles éternue et que ce sondage peut très bien s'adapter à notre région. A la question "que faut-il pour qu'une femme réussisse sa vie?", elles répondent à 82 % de 15 à 55 ans : d'abord, un métier, ensuite un bébé. "Pourquoi la liberté ne serait-elle pas aussi contagieuse que le fanatisme ou l'intolérance?", écrit à juste titre, le journaliste du Nouvel Observateur.
2. L'Arsenal juridiqueLes dispositions législatives du droit social doivent encourager l'égalité des sexes dans les foyers à travers la prise de responsabilités des hommes dans la garde des enfants et dans les tâches ménagères. Elles ne doivent pas structurer le congé parental, "alibi" qui décourage l'homme de le prendre en en faisant, par voie de conséquence, une quasi exclusivité des mères travailleuses. A cet égard, l'exemple de la Suède mérite toute notre attention (déclaration de Monsieur Peter Moss, coordinateur de la Commission européenne pour le Réseau d'Accueil des Enfants - journée d'étude de Réseau belge du 14.03.90).
3. Garde - éducation = même combatIl est recommandé de ne plus traiter séparément la garde et l'éducation des enfants, et d'organiser une politique cohérente d'accueil jusqu'à 10 ou 12 ans minimum, moyennant une planification des moyens nationaux (Fonds des équipements collectifs de l'Office national des allocations familiales) et des moyens régionaux (pourquoi pas un département wallon du bien-être social impliquant et subsidiant les Pouvoirs locaux selon des formules de financement et d'organisation de caractère public ou mixte?). 4. Le social est à l'économique ce que l'économique est au socialIl importe de faire comprendre aux employeurs qu'il faut créer des conditions favorables à la famille, par des mesures législatives ou conventionnelles qui rencontrent une série de responsabilités familiales qui ne concernent pas seulement les enfants, mais les hommes et les femmes. Certes, des dispositions légales nationales existent déjà (Ministère du Travail et de l'Emploi) telles : pause-carrière, congé sans solde, jours de congés non rémunérés pour raisons familiales impérieuses. Mais ces dispositions ne sont accessibles qu'aux femmes qui peuvent se passer d'un salaire ou qui n'entendent pas assumer une véritable carrière professionnelle. De surcroît, ces formules désorganisent le travail par des allers-retours peu productifs créant au sein des entreprises ou des services, un noyau de personnel à statut précaire, dépendant de la volonté des demandeurs des mesures précitées. Là n'est vraiment pas l'intérêt des employeurs et des femmes en particulier. C'est ainsi que les organisations syndicales du commerce où beaucoup de femmes sont occupées ont formulé des propositions concrètes, de portée conventionnelle devant la commission paritaire compétente pour que, dans la partie des 0.25 % de la masse salariale réservée à la promotion de l'emploi des groupes à risques, une proportion soit réservée à des actions positives en faveur des travailleuses. Il s'agit :
Il faut remarquer que ces propositions s'inscrivent dans un esprit de solidarité entre travailleurs qui cotisent systématiquement et proportionnellement, quel que soit le sexe ou le degré de qualification. En outre, elles rejoignent les conclusions de la journée d'études du Réseau belge des modes d'accueil des enfants du 14 mars 1990 qui spécifient que les employeurs doivent prendre une part directe au financement de l'accueil des enfants, mais à titre complémentaire aux services locaux (communaux ou intercommunaux). Il faut savoir qu'il existe un autre courant favorable à la création de crèches d'entreprises qui est loin d'être la panacée. En effet, il est ambigu de faire dépendre l'éducation de l'enfant de l'emploi des parents. Des crèches se développeraient au sein des grandes entreprises occupant beaucoup de main-d'oeuvre féminine risquant d'exclure toute une frange d'autres travailleurs et laissant inchangé le problème général des crèches. On peut craindre aussi qu'une crèche d'entreprise lie l'engagement à la présence ou non d'enfants et puisse constituer un moyen de pression sur les travailleurs : qu'est-ce qui les empêche de rester une heure de plus puisque leurs enfants sont en sécurité? Pourtant, dans une stratégie de disponibilité de main-d'oeuvre, l'entreprise a tout à gagner à contribuer au développement de l'accueil de la petite enfance. La solution peut s'imaginer sur le modèle de l'assurance maternité : on solidariserait ainsi le coût de l'accueil comme on le fait pour la maternité par la cotisation à un fonds quels que soient le sexe et le nombre de travailleurs occupés, en fonction du chiffre d'affaires ou des bénéfices de l'activité. Cette orientation permettrait de réfléchir à la gratuité des services de garde des enfants. (La Nouvelle Gazette, magazine du 22.08.90). Le FESC (Fonds des Equipements et des Services collectifs de l'ONAFTS) devrait subir une réforme structurelle indispensable à la réalisation de l'égalité des chances. Les services collectifs d'accueil à la petite enfance doivent prioritairement être ouverts aux enfants des femmes ou des parents qui sont sur le marché du travail ou qui sont en formation - soit dans la filière normale de l'enseignement soit dans des stages plus spécifiques pour y entrer ou y revenir afin de les suppléer ou de les remplacer dans leurs tâches éducatives pendant leur horaire de travail ou de formation, que ceux-ci se situent à l'intérieur ou en dehors des heures et des jours normaux de travail, comme c'est le cas non seulement des travailleurs qui font les pauses mais aussi d'un nombre considérable de travailleurs indépendants. S'il apparaît bien que le bénéfice de ce type de service doit être reconnu comme un droit des travailleurs afin de leur permettre de remplir leurs obligations professionnelles sans pour autant que celles-ci entrent en compétition avec leurs obligations familiales, ce bénéfice est considéré aussi comme un droit des enfants dont les parents travaillent puisqu'il se trouve inscrit comme tel dans la récente Convention des Droits de l'Enfant des Nations unies (art. 18, al. 3). Les Etats parties devraient par conséquent prendre des mesures appropriées pour le leur assurer. C'est à ce double titre (cotisations sociales liées au travail qui doivent assurer aussi le droit des travailleurs à avoir et à élever une famille sans que celle-ci puisse en aucun cas constituer une entrave à l'exercice normal de leur activité professionnelle et ainsi porter préjudice au développement normal de leur carrière, et prestation familiale en service comme droit des enfants des travailleurs) que le financement des services et équipements collectifs d'accueil à la petite enfance relève de la sécurité sociale et donc de la solidarité entre tous les travailleurs. A quand l'assurance équipement collectif ? 5. Impératifs budgétaires ?Pour bien évaluer ce que l'on dépense, il faut évaluer les besoins et ce qu'ils coûtent. Une enquête relative à la demande par l'utilisation des modes d'accueil a été réalisée dans la Communauté flamande. Elle est inexistante dans la Communauté française (P.C. Humblet, Ecole de santé publique, ULB, B. Mendiaux, Service d'étude Ligue des familles). Une carence totale de données sur les besoins d'accueil extra-scolaires des enfants de plus de trois ans et une égale carence de données sur l'offre d'accueil, sont un double constat des deux rapporteurs précités à la journée du 14 mars 1990 du Réseau belge des Modes d'Accueil des Enfants. Comment les pouvoirs organisateurs peuvent-ils décemment arguer de leurs possibilités ou impossibilités financières sur un problème prioritaire non identifié? Quoi qu'il en soit, des pistes de financement existent (quelques-unes ont été effleurées dans les points précédents) et des réserves financières existent (10 milliards à l'ONAFTS, utilisation spécifique pour équipements collectifs des 675 F retenus chaque mois aux travailleurs salariés sans enfants). Ces ressources qui ont été créées doivent être dévolues aux besoins de la garde des enfants et non pas être destinées à d'autres secteurs tels que l'AMI ou les pensions tant que des pénuries criantes de garde existent en tous cas. 6. Solution de gardeIndépendamment des crèches traditionnelles :
7. La flexibilité positiveCe qui est vrai pour les équipements collectifs, l'est tout autant pour les horaires de travail. La flexibilité positive ("à la carte" pour les travailleurs plutôt que pour les employeurs) serait d'ailleurs de nature à régler bien des problèmes de relation famille-travail surtout si elle s'accompagne d'une réduction de la durée de travail. Exemple : 36 heures, ça peut être quatre fois 8 heures et 1 fois 4 heures, ce qui peut laisser libre le mercredi après-midi. La formule paraît moins "ghetto" et est financièrement plus intéressante car elle n'implique pas de perte de salaire pour les couples avec enfants. C'est notamment le cas pour les congés familiaux non rémunérés, inaccessibles aux bas salaires et aux personnes seules avec enfants confrontés à des problèmes de garde aigus.
8. Absences rémunéréesLe paiement des salaires pour jour d'absence autorisé pour raisons impérieuses (actuellement non rémunérés) pourrait être aussi solidarisé comme l'assurance maternité, ou payé par le Fonds de l'Emploi. Cela permet à tous les travailleurs concernés d'en être bénéficiaires quelles que soient la dimension et la prospérité de l'entreprise. 9. Autres réseauxL'insertion professionnelle harmonieuse de l'homme et de la femme ne peut se contenter de discussion "fuite en avant" ou "tape à l'oeil", cloisonnées en divers endroits de décision. Elle doit passer par la recherche de solutions concertées entre les différents niveaux de pouvoirs (sécurité sociale, fiscalité, enseignement, aide aux familles, logement, services aux personnes âgées, etc..). Si le problème des enfants est important, il n'est pas le seul pour les couples qui travaillent. Quel comportement adopter lorsque le père ou/et la mère des enfants rencontrent des difficultés de santé passagères, mais renouvelées les rendant plus ou moins dépendants de leurs enfants sans pour autant engendrer le placement en maison de repos? (accompagnement chez les médecins, à l'hôpital, aux soins, lessive, courses, etc...). Une fois encore, c'est la femme travailleuse qui encaisse souvent le coup. Si certains aspects sont rencontrés plus ou moins par des administrations locales voire des asbl (Aides-familiales, repas chauds, coordination des soins à domicile), il n'existe néanmoins pas une politique globale wallonne en la matière. Il faudra plus tôt que tard s'y atteler compte tenu de l'allongement général de l'âge moyen de vie des individus et du caractère irréversible de l'entrée des femmes dans l'économie régionale. (Octobre 1991) (Ce texte est extrait de : QUEVIT Michel (sous la direction de), La Wallonie au Futur, Le défi de l'éducation, Actes du Congrès, Institut Jules Destrée, Charleroi, 1992.)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
www.institut-destree.eu - www.institut-destree.org - www.wallonie-en-ligne.net © Institut Destrée - The Destree Institute
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||