| Conférence - Consensus La Wallonie au Futur Namur - 1994 Où en est
et où va |
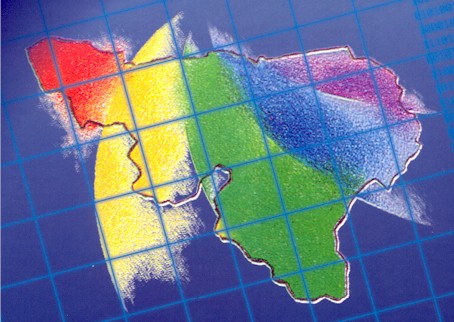 |
L’approche
économique L’approche sociologique Synthèse du troisième débat |
| Conférence - Consensus La Wallonie au Futur Namur - 1994 Où en est
et où va |
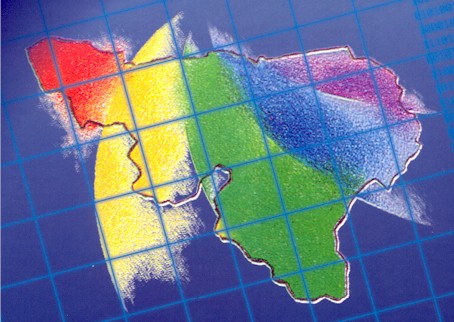 |
L’approche
économique L’approche sociologique Synthèse du troisième débat |
Les membres du panel des citoyens retiennent, de l’approche sociologique qui leur a été présentée, un véritable recueil de carences mettant en évidence des effets pervers, des flous artistiques, des problèmes sans solution. Ainsi, on s’interroge sur la division du secondaire en cycle, sur l’allongement des études secondaire, le taux élevé de chômage des jeunes, la définition des objectifs.
Bernard Delvaux redéfinit la notion d’objectif comme étant ce qui permet de voir dans quel sens la totalité du système doit aller et qui répond à toutes les questions pratiques, pragmatiques. Si l'école seule poursuit cet objectif, il est évident qu’elle est perdante. L'objectif de l'école doit s’intégrer parmi ceux qui sont défendus par d’autres macro-institutions de la société. Quand on a lancé un projet de démocratisation de l'enseignement dans l'immédiat après-guerre, on essayait aussi de faire de la démocratie économique, c'est-à-dire de permettre au travailleur de participer à la gestion de l'entreprise; quelques années plus tard, on a essayé de dire la messe autrement qu'en latin, de faire en sorte que le commandement à l'armée y soit fait avec des ordres compréhensifs. L’objectif global est donc d'installer la démocratie dans toutes les instances où l'homme rencontre le social : l'école peut sans aucun problème servir cet objectif et le faire bien. Malheureusement, à l’heure actuelle, plutôt que de définir avec soin ses propres objectifs, chaque société tente de s’ajuster sur ceux de ses voisins, ce qui n’apporte rien de constructif. A partir du moment où la société ne sait plus dans quel sens elle doit aller, l'enseignement le sait encore moins. Il faut impérativement tenir compte de la situation réelle de la société à moyen terme afin de ne pas s’engager dans une politique d’éducation qui conduirait de toute manière les jeunes diplômés vers le chômage.
De son côté, Jean-Emile Charlier constate que la production d’informations de pilotage à partir de la récolte d’indicateurs ne peut que creuser davantage le fossé existant entre les enseignants qui seront à même de les utiliser et ceux qui n’en seront pas capables. D’autre part, étant donné la complexité du contexte social qui est le nôtre, il est impossible d’arriver à un consensus sur les objectifs parce que nous n’avons pas les moyens - politiques, économiques et culturels - de nous l’offrir. Il faut donc construire des indicateurs et les diffuser, mais il n’est pas possible de présenter cette démarche comme une victoire.
De même, Anne Van Haecht oppose la situation en France, où une réflexion intense analyse les politiques d’éducation depuis une dizaine d’années - ce débat d’idées nourri par les chercheurs aboutissant à des résultats - à la situation que nous vivons chez nous, c’est-à-dire une épouvantable lacune au niveau de la politique scolaire. Chaque société doit donc élaborer sa propre politique en fonction de sa culture et de sa structure éducative.
Dans cette perspective, Claude Thélot suggère d’établir des passerelles entre le monde éducatif et le ministère de l’Education. Il faut arriver à faire émerger des objectifs, bien que ce soit difficile, parce que ces objectifs vont tirer le système éducatif. Le Directeur français de l’Evaluation et de la Prospective a mesuré les lacunes au niveau de la maîtrise de la lecture et le Ministre français de l’Education nationale en a isolé un objectif général portant sur la réduction significative de cette lacune chez les jeunes adolescents. Il faut conserver des objectifs généraux, des diplômes nationaux et prendre soin de valoriser, sur le marché du travail, les différentes formations offertes par le système éducatif.
Quant au chômage des jeunes, il n’est pas directement imputable au système éducatif, mais celui-ci ne peut pourtant pas s’en dire irresponsable. Les causes externes - principalement économiques - qu’un pays ne parvient pas à maîtriser totalement ne peuvent empêcher d’organiser le sas indispensable entre le sens de l’école et celui de la vie de la société.
Les chercheurs mettent peut-être trop l’accent sur les effets pervers. La diffusion d’informations, au travers de l’évaluation et d’une meilleure maîtrise collective, provoque souvent des prises de conscience qui permettent de progresser. Il faut savoir prendre le risque et corriger ensuite, s’il y a lieu, les effets pervers. Il vaut mieux travailler sur des objectifs susceptibles de produire des effets pervers plutôt que de ne pas avoir d’objectifs du tout. La construction de la société est à ce prix.
Confirmant ce dernier point, Gilbert de Landsheere estime que, dans la mesure où les solutions parfaites et indiscutables n’existent pas, il faut avoir le courage de l’imperfection. Nous vivons sur des paris en ignorance sereine de la globalité de la nature du phénomène. Il est impossible d’envisager une décision en tenant compte de la totalité des interactions possibles. Nous devons avancer malgré tout, en toute modestie, en fonction de ce constat. Supprimer la boussole de l’éducation équivaut à tuer les enfants car, à partir du moment où une famille n’accepte pas d’opter pour certaines règles, valeurs ou lignes de conduites, l’enfant est complètement perdu. Il en va de même pour l’enseignement.
Nous entrons dans une nouvelle tranche de civilisation qui est la civilisation de l’intelligence. Ceux qui en sont conscients installent rapidement le pilotage : le sort et l'espoir d'un jeune sont en danger s’il ne s'assume pas au maximum des chances qu'on doit lui donner pour s'insérer dans cette civilisation. Nous sommes toujours en train de chercher l'équation d'une société, d'une civilisation qui existe et d’un jeune qu'il faut y insérer en lui permettant de le faire dans les meilleures conditions.
(Mars 1994)
 |
Page mise à jour le 23-08-2004 |
|
|
|
||
|
Tous droits réservés © Institut Jules-Destrée |