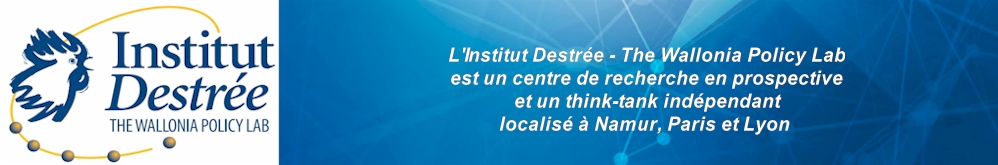|
Education et
technologies nouvelles : une autre facette de la problématique des
rapports formation - emploi
Jean-Louis
Canieau
Licencié en Sciences économique
(ULg)
Agrégé de l'Enseignement secondaire supérieur en Sciences économiques
appliquées (UEM) - Assistant à l'UEM - Chaire de Macro-économie du
Professeur Vandeville
Marcelo Ossando
Chercheur à l'UEM
1.
Introduction
Avec l'approfondissement
de la crise économique, on assiste, depuis une dizaine d'années, à une extension
progressive du chômage à des couches de plus en plus larges de la main-d'œuvre
instruite et à une précarisation croissante des emplois offerts aux jeunes
diplômés. Cette précarité, qui correspond à une dévalorisation des statuts
socioprofessionnels concomitante à la dévalorisation générale des titres
scolaires
(1),
se traduit notamment à travers le succès du travail à temps partiel et des
programmes de mise au travail des chômeurs (CST, TCT, CMT,...) ainsi que par la
multiplication des engagements à répétition sur des contrats d'emploi à durée
déterminée. Le phénomène prend actuellement une telle ampleur que même les
diplômés universitaires, qui, jusqu'ici, semblaient relativement à l'abri, ne
peuvent désormais y échapper
(2).
Face à cette situation,
le diagnostic qui continue à être porté s'exprime, le plus souvent, en termes
d'inadéquation quantitative et/ou qualitative de l'éducation aux besoins de
l'économie. C'est ainsi que les solutions préconisées gravitent généralement
autour de deux pôles, soit que l'on envisage de limiter l'accès aux filières
éducatives en panne de débouchés
(3),
soit que l'on porte l'accent sur l'adaptation des formes et des contenus de
l'enseignement aux nécessités de la vie économique. Tous les discours qui se
tiennent aujourd'hui sur le thème des rapports entre la formation
professionnelle et l'emploi d'un part, et entre celle-ci et le progrès
technologique d'autre part, doivent à l'évidence être analysés sous cet angle.
Bien que se situant dans un contexte totalement différent, ils témoignent d'un
retour aux sources de la théorie du capital humain.

2. Croissance, progrès
technique et théorie du capital humain
Si l'on doit aux
économistes classiques du XVIIIe siècle d'avoir souligné le rôle que joue
l'apport combiné de trois facteurs de production traditionnels (terre, capital
et travail) sur le produit d'une nation, le fait qu'ils considéraient ces
facteurs comme étant homogènes devait entraîner des conséquences durables sur
l'explication de la croissance. En ce qui concerne plus spécialement la
main-d'œuvre, l'hypothèse, formulée par Ricardo, de l'homogénéité du travail
signifiait que toutes les heures de travail étaient jugées équivalentes du point
de vue productif et ce, quelles que fussent l'habileté et la compétence des
hommes qui les fournissaient. Il s'ensuivait que :
1. les facteurs de
production devaient être parfaitement substituables;
2. les dépenses
susceptibles d'accroître les capacités humaines n'entraient pas en ligne de
compte, puisque la qualité de la main-d'œuvre n'influençait pas la productivité.
Partant de là, et
raisonnant dans le cadre d'une technologie donnée, les premiers économistes
classiques n'avaient donc qu'une vision purement quantitative de la croissance :
celle-ci pouvait résulter que de l'augmentation de l'un au moins des trois
facteurs et, pour ce qui regarde la main-d'œuvre, de l'augmentation, soit du
nombre de travailleurs, soit du nombre d'heures de travail. Le fait que ces
variables soient soumises à de fortes contraintes, tant sociales que
démographiques, explique que pendant longtemps l'attention des économistes se
fixa exclusivement sur le processus d'accumulation du capital physique et sur le
rapport "capital-produit" (capital-output ratio), dont on décréta qu'il était
normalement stable.
L'analyse keynésienne,
peu concernée par les problèmes de croissance, ne devait pas modifier cet état
d'esprit. Keynes lui-même considérait en effet le travail comme un facteur de
production passif dont l'emploi, ou le non-emploi, dépend de l'existence d'un
investissement en capital physique suffisant, compatible avec le niveau de
l'épargne disponible. Ainsi, dans les modèles keynésiens, la main-d'œuvre est
toujours supposée homogène et déterminée par un mécanisme exogène d'adaptation
au stock de capital physique, dont le taux d'accroissement constitue "la
variable clé affectant le niveau d'activité de l'économie"
(4).
Ce n'est en réalité qu'au
lendemain de la guerre que, suite à une série d'études sur les causes de la
croissance aux Etats-Unis, le doute commença à s'emparer des économistes. Ces
études révélèrent notamment que, depuis le début du siècle, le taux de
croissance du PNB américain avait été supérieur à celui de la formation brute de
capital et que, corrélativement, le "capital-output ratio" avait sensiblement
diminué. Parallèlement, diverses analyses économétriques montrèrent que, un peu
partout dans le monde, la contribution des trois facteurs traditionnels à la
croissance était assez faible. Pour la période allant de la fin des années vingt
aux années cinquante, ces facteurs n'expliquaient en effet que la moitié, au
plus, de l'augmentation du revenu national en Europe occidentale et au Japon
(5).
Ces constatations
suggérèrent qu'un facteur important de la croissance avait été oublié. En
l'occurrence, l'idée se fit jour que l'on ne pouvait pas raisonner dans le cadre
d'une technologie donnée, c'est-à-dire en supposant que la qualité des inputs
était invariable. On attribua par conséquent l'existence des "résidus de
croissance" à l'action du progrès technique, en visant par là les améliorations
apportées dans l'efficacité des facteurs de production et l'incidence de cette
efficacité accrue sur les résultats de leur combinaison.
Tout d'abord, le
mouvement conduisit les économistes à s'interroger sur la manière de prendre le
progrès technique en considération de façon à pouvoir mesurer ses effets sur les
variations du produit. Les réponses à cette question se concrétisèrent dans deux
types de démarches. La plus ancienne, et aussi la plus simple, consista à
envisager le progrès technique comme une entité autonome par rapport aux inputs
traditionnels, en traduisant l'augmentation tendancielle de leur efficacité par
l'introduction, au sein des fonctions de production, d'un coefficient
amplificateur croissant dans le temps
(6).
Bien que statistiquement satisfaisante pour décrire les évolutions passées de la
croissance (on pourrait d'ailleurs se demander si elle le serait encore
aujourd'hui), cette méthode n'apportait évidemment rien sur le plan explicatif.
D'une part, étant donné le recours aux formes classiques de la fonction de
production, en particulier la Cobb-Douglas, le progrès autonome était assimilé à
un facteur tiers parfaitement substituable aux autres inputs; d'autre part, il
constituait en soi un véritable "fourre-tout" dans lequel figuraient
indistinctement toutes les sources possibles des "résidus de croissance",
rendant du même coup la méthode inopérante pour éclairer des choix de politique
économique
(7).
Plus ambitieuse et plus complexe, la seconde démarche revint au contraire à
supposer que le progrès technique se trouvait incorporé aux facteurs de
production. Selon cette optique, les lacunes de l'analyse classique "archaïque"
résidaient dans le fait que l'on n'avait pas jusqu'alors saisi correctement la
contribution des inputs. Tous les efforts devaient donc porter sur la révision
des instruments de mesure pour tenir compte des variations qualitatives, et non
pour seulement quantitatives, des facteurs, et réduire ainsi l'importance du
résidu statistique. Les tentatives en ce domaine prirent deux directions
principales : soit l'incorporation du progrès technique au capital tangible,
notamment par l'utilisation d'une fonction à générations de capital permettant
d'introduire les gains de productivité liés à l'amélioration technologique des
nouveaux matériels
(8);
soit encore son incorporation au facteur travail via, entre autres, les effets
de l'augmentation du niveau général d'éducation sur la qualification, et donc la
productivité de la main-d'œuvre
(9).

Nous ne pouvons pas, dans
le cadre de cette communication, nous attarder sur ces deux conceptions du
progrès technique "incorporé", ni en retracer les avantages et les limites
respectives. A l'analyse, elles paraissent complémentaires, de sorte que l'on
pourrait, à l'instar de ce que préconise Jean-Louis Maunoury, envisager la
construction de modèles à double incorporation, à la fois au capital et au
travail
(10).
Pour l'objet de notre
propos, c'est évidemment la contribution du facteur éducatif à la croissance qui
retient le plus notre attention. Bien que fortement controversée, la méthode
développée en 1962 par Edward F. Denison
(11)
continue, aujourd'hui encore, à marquer les esprits. Son originalité propre
tient au fait qu'elle combinait les principes des deux démarches précédentes.
Dans un premier temps, Denison s'est ainsi efforcé d'ajuster la mesure des
inputs de travail pour tenir compte, notamment, de l'effet de l'augmentation du
stock d'éducation sur la qualité de la main-d'œuvre; dans un second temps, il a
ensuite essayé d'estimer la contribution des facteurs d'amélioration de la
productivité non incorporables au travail en décomposant le "résidu de
croissance" en plusieurs éléments de progrès "autonome", parmi lesquels les
économies d'échelle liées au développement de la production et le progrès
général des connaissances se taillaient la part du lion. Au total, pour la
période allant de 1929 à 1957, Denison en arrivait à situer la contribution de
l'éducation au taux de croissance des Etats-Unis à environ 43 %; répartis à
raison, de 23 % pour les effets directs sur la productivité du travail et 20 %
pour les effets "diffus" sur la productivité globale. Dans une étude ultérieure
sur la disparité de taux de croissance observés au sein d l'OCDE entre 1950 et
1962, et en utilisant une méthodologie identique, il estimait cette même
contribution de 24 % à 45 % selon les pays, la moyenne européenne oscillant aux
alentours de 33 %
(12).
Ces études eurent, sur
l'évolution de la pensée économique contemporaine, une influence déterminante :
en confirmant par les chiffres la vieille intuition d'Adam Smith, lequel
entrevoyait l'importance de la qualité de la main-d'œuvre comme source de
richesse nationale
(13),
elles contribuèrent, au début des années soixante, au succès fulgurant de la
théorie du capital humain. On observera cependant que les préoccupations qui
s'exprimaient à travers ces analyses étaient avant tout d'ordre statistique :
si, d'une manière ou d'une autre, elles cherchaient à évaluer les effets du
progrès technique sur la croissance, elle n'expliquaient hélas pas pourquoi ce
progrès existait, l'instituant simplement comme un fait acquis. Il est certain
qu'en traitant l'éducation comme l'une des causes directes majeures de
l'amélioration de la productivité du travail, les analyses de Denison échappent
en partie à cette critique, mais en partie seulement. C'est ainsi qu'elles
ignorent tout de l'action du progrès sur la productivité du capital, sauf à
considérer qu'elle se retrouve dans la contribution "résiduelle" de
l'accumulation des connaissances et de la diminution des délais d'application du
savoir, ces deux facteurs autonomes traduisant eux-mêmes l'effet médiat de
l'éducation et de la recherche du double point de vue de la diffusion du savoir
et de l'acquisition comme de la mise en oeuvre économique des connaissances
nouvelles. Mais l'objection fondamentale que l'on peut adresser à toutes ces
tentatives d'incorporation du progrès aux inputs, c'est que le formidable effort
de formalisation qu'elles réalisent conduit immanquablement leurs promoteurs à
ne retenir qu'un nombre limité de relations explicatives tout en s'appuyant sur
des hypothèses simplificatrices pas toujours vérifiables et parfois
contradictoires
(14).
Des multiples
controverses suscitées autour de ce problème, il devait ressortir que si les
économises songent moins que jamais à nier le rôle permissif de la formation sur
le développement des capacités de recherche, d'invention et d'innovation, voire
même sur l'efficacité des décisions d'investissement qui sous-tendent la
croissance, ils savent désormais que ce rôle ne peut se concevoir que dans un
système complexe d'interactions entre tous les actifs tangibles et intangibles
qui participent "à l'activité finale de production en même temps qu'aux
activités intermédiaires d'éducation et de recherche, lesquelles à leur tour
permettent la formation d'actifs intangibles"
(15).
Si l'on adopte une approche systématique large, il est clair qu'il faudrait
ainsi compter, au rang des actifs intangibles que l'éducation contribue à
transmettre, plus sans doute qu'à transformer, le patrimoine socioculturel avec
son lot de valeurs et d'attitudes conservatrices ou stimulantes à l'égard de
l'activité économique. Dans cette perspective, cela signifie aussi qu'il devient
probablement illusoire de vouloir à tout prix isoler les effets de l'éducation
sur le progrès technologique et la croissance.

3. Théorie du capital
humain et marché de l'emploi
Dans le même temps où
elle attribue une part non négligeable de la croissance à l'accumulation des
actifs intangibles, dont le capital intellectuel incorporé ne constitue qu'une
composante, la théorie néoclassique assigne au marché de l'éducation une
fonction d'ajustement entre la production du système scolaire et les besoins de
l'économie en compétences. En se basant sur le paradigme de 'Homo oeconomicus"
et sur les hypothèses classiques de la concurrence parfaite ainsi que de la
liaison de la rémunération à la valeur de la productivité marginale du travail,
elle-même supposée déterminée positivement par le niveau éducatif, cette théorie
place en fait le libre choix individuel au centre de l'analyse. Dans un univers
économique idéal où toutes les conditions se trouvent réunies pour que le marché
assure seul la régulation entre les offres et les demandes de qualifications,
l'individu est entièrement responsable de ses décisions d'investissement
intellectuel, et partant, de son avenir professionnel. S'il ne découvre pas
d'emploi à l'issue de ses études, ou si les conditions d'emploi qu'on lui
propose ne sont pas satisfaisantes, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même,
soit qu'il n'ait pas investi suffisamment dans sa formation, soit que, cédant à
ses goûts" plutôt qu'à une sain raison économique, il ait investi dans de
mauvais créneaux scolaires.
En d'autres termes, si
les économistes néoclassiques ne nient pas l'évidence de phénomènes très actuels
comme le chômage ou le sous-emploi de la main-d'œuvre qualifiée, ils ont
cependant tendance à ne voir en ceux-ci que des "accidents de parcours" dus à
des dysfonctionnements de l'économie de marché. Les causes en seraient multiples
et se situeraient aussi bien du côté des produits du système éducatif
(intervention abusive de l'Etat dans le financement de l'enseignement, inégale
répartition des ressources à consacrer à l'éducation, disparité des qualités
"naturelles", rigidité des structures scolaires...) que du côté du marché de
l'emploi (information insuffisante sur les emplois disponibles et/ou sur les
capacités productives des diplômés, fixation de salaires trop élevés dans le
secteur public, rigidité des salaires à la baisse, etc.). Dès lors, il suffirait
de supprimer ces distorsions - parfois contradictoires, hélas ! - pour que, à
terme, le marché reprenne sa fonction de régularisation et assure à nouveau
l'ajustement automatique entre le stock de capital-éducation et l'emploi
(16).
Il est évident que dans
l'optique néo-libérale, les deux aspects de la problématique, à savoir
croissance et emploi, sont indissociablement liés. En effet, il paraît logique
d'admettre que les gains de productivité que le progrès technique et
l'amélioration qualitative du facteur humain entraînent ne seront compatibles
avec le plein-emploi que dans la mesure où la croissance sera assez soutenue
pour maintenir la demande de main-d'œuvre à un niveau maximal et assurer ainsi
l'absorption des produits du système éducatif par les structures économiques.
Dans le cas contraire, l'augmentation de la productivité se traduirait
inéluctablement par des pertes d'empois et l'apparition d'un chômage structurel
de pus en plus important et ce, quelle que soit l'adaptabilité de l'appareil de
production scolaire aux besoins de l'économie. Ceci revient à dire que pour
rester consistante, la théorie du capital humain implique que tout effort en
matière d'éducation ne constitue pas simplement un investissement
d'accompagnement, créant les conditions plutôt que les moyens de la croissance,
mais qu'il est en lui-même générateur de croissance, c'est-à-dire productif. A
la limite, on ne pourra assimiler la première forme d'investissement à la
seconde que si l'on suppose que le système économique assure à tout moment une
exploitation intégrale des potentialités de développement associées au stock de
capital humain disponible, cette allocation optimale des ressources n'étant à
son tout rendue possible que dans le cadre strict des hypothèses classiques
évoquées plus haut.

4. Les conséquences sur
les politiques éducatives des "Golden Sixties"
Il n'échappera à personne
que, depuis un quart de siècle, les politiques éducatives se sont largement
inspirées des préceptes néo-classiques. C'est ainsi que dans les années
soixante, alors que la croissance paraissait un phénomène irréversible, on a
assisté, dans tous les pays de l'OCDE, à une véritable explosion des effectifs
scolaires, spécialement dans les enseignements du 3e degré, tant
universitaires que non-universitaires. Ce mouvement, qui trouvait ses origines à
la fois dans l'évolution démographique de l'immédiat après-guerre et dans les
aspirations socio-économiques des populations, fut encouragé par les pouvoirs
publics dont les dépenses d'éducation grimpèrent de manière vertigineuse. En ce
qui concerne la Belgique, on constate par exemple que si, de 1955 à 1975, la
population scolarisée s'est accrue en moyenne de 2 % par an, par contre, dans le
même temps, les dépenses de l'Etat en matière d'enseignement augmentaient, en
termes réels, à un taux annuel moyen de près de 10 %. Si l'on raisonne en termes
de progression du coût moyen par élève au cours de cette période, on ne pourra
nier que l'enseignement primaire fut le principal bénéficiaire de ces
interventions croissantes de l'Etat belge - constatation toujours d'actualité en
dépit de la diminution du nombre d'élèves survenue depuis lors à ce niveau
(17).
Il n'en demeure pas moins que, dans l'absolu, ce fut l'enseignement
universitaire qui enregistra les plus gros succès, avec une hausse annuelle
moyenne de 6,4 % pour la fréquentation et de 12,4 % pour les moyens financiers
exprimés à prix constants.
Ce résultat n'a en soi
rien d'étonnant. En accord avec les apports de la théorie du capital humain, il
était en effet communément admis, à l'époque, que le temps et l'argent consacrés
à la formation constituaient, en raison de l'augmentation subséquente de la
productivité un investissement rentable, tant pour l'individu que pour
l'ensemble de la collectivité. L'élévation du niveau général d'éducation, et
donc le développement de l'enseignement supérieur, devinrent ainsi l'un des
objectifs fondamentaux de la politique éducative en Belgique. La réforme de
l'enseignement secondaire, l'institutionnalisation des formations continuées
(instauration du congé de formation générale en 1963, des crédits d'heures en
1973), l'application des lois de 1965 à 1971 sur l'expansion universitaire et le
financement des universités, furent autant de témoignages de cette volonté des
pouvoirs publics de permettre au plus grand nombre de personnes de pousser leur
formation le plus loin possible. A travers tous les discours qui fleurissaient
alors sur la démocratisation des études et la nécessité de créer une "université
de masse", le souci d'ouvrir au maximum les portes de l'enseignement supérieur
trouvait sa justification économique dans les prolongements logiques de la
théorie. D'une part, on pensait que l'augmentation du stock de capital humain
devait fatalement entraîner des effets positifs plus puissants sur le niveau de
production que ceux résultant de simples changements dans la composition du
capital physique, cette croissance permettant à son tour, dans les conditions de
concurrence parfaite et de substituabilité des facteurs définis par la théorie,
d'absorber sans heurts les flux de diplômés déversés sur le marché de l'emploi.
D'autre part, on croyait aussi que l'élévation du niveau moyen d'éducation se
traduisant par une augmentation de la productivité, et donc des salaires, on
assisterait de la sorte à une réduction progressive des inégalités de revenus.

5. Les incidents de la
crise économique
La crise, dans la seconde
moitié des années septante, allait réduire ce beau rêve en miettes. Tout
d'abord, on s'aperçut que si les effectifs estudiantins, et donc le nombre de
diplômés, continuait à croître bien qu'à un rythme moins soutenu qu'au cours de
la décennie précédente, l'économie, en revanche, entrait dans une phase de
croissance faible, pour ne pas dire quasi-nulle. Circonstance aggravante, cette
disparition des effets repérables de l'éducation sur la croissance s'accompagna,
simultanément, d'une extension rapide du chômage et du sous-emploi à une
population active qui semblait jusque là protégée, en l'occurrence la
main-d'œuvre instruite, au sein de laquelle les jeunes et les femmes furent les
premiers touchés. Le tableau 1, que nous reproduisons à tire illustratif, rend
parfaitement compte de ce phénomène de détérioration généralisée de l'emploi.
Chose assez surprenante, on voit même que le taux de chômage des universitaires,
hommes et femmes confondus, aurait davantage progressé (accroissement annuel
moyen de 11,9 %) que celui des diplômés de l'enseignement normal (+ 9,9 %) ou du
technique supérieur (+ 10 %), ce résultat venant ébranler la conviction
classique selon laquelle le titre universitaire constituerait une sorte de
passeport pour l'emploi. A cela, il convient encore d'ajouter que nulle part
l'on n'a assisté à une amélioration dans la répartition des revenus suite à
l'allongement des études. C'est ainsi qu'aux Etat-Unis, en 1972, les hommes de
35-44 ans avec quatre années d'études supérieures gagnaient 2,1 fois plus que
ceux totalisant huit années d'études, alors qu'en 1960 leur avantage n'était que
de 1,9 fois plus
(18).
Taux de chômage de la
population de 14 ans et plus selon le niveau d'instruction
|
NIveau d'instruction |
1970 (1) |
1977 (2) |
1981 (3) |
taux d'acc. annuel moyen 1970 - 1981 (en %) |
|
|
H |
F |
T |
H |
F |
T |
H |
F |
T |
H |
F |
T |
|
Non diplômé ou niveau d'instruction inconnu |
|
|
|
|
|
|
11,23 |
22,87 |
15,06 |
|
|
|
|
Niveau primaire |
2,44 |
3,62 |
2,77 |
4,19 |
14,60 |
7,46 |
10,15 |
22,59 |
14,24 |
+13,84 |
+18,11 |
+16,05 |
|
Niveau secondaire inférieur |
0,84 |
2,59 |
1,37 |
2,43 |
11,40 |
5,26 |
6,21 |
19,25 |
10,78 |
+19,96 |
+20,03 |
+20,62 |
|
Formation générale |
0,98 |
2,15 |
1,40 |
2,46 |
9,38 |
5,21 |
5,77 |
15,03 |
9,72 |
+17,49 |
+19,34 |
+19,26 |
|
Formation technique ou professionnelle |
0,76 |
2,79 |
1,35 |
2,41 |
13,96 |
5,30 |
6,38 |
21,94 |
11,28 |
+21,34 |
+20,62 |
+21,29 |
|
Niveau secondaire supérieur |
1,06 |
2,31 |
1,44 |
2,50 |
8,79 |
4,64 |
4,81 |
14,75 |
8,63 |
+14,74 |
+18,36 |
+17,68 |
|
Formation générale |
1,12 |
2,21 |
1,42 |
2,74 |
7,61 |
4,44 |
4,80 |
12,61 |
7,84 |
+14,14 |
+17,15 |
+16,80 |
|
Formation technique ou professionnelle |
0,99 |
2,39 |
1,47 |
2,27 |
9,96 |
4,82 |
4,82 |
16,23 |
9,17 |
+15,48 |
+19,02 |
+18,11 |
|
Niveau supérieur pédagogique (normal) |
0,40 |
1,66 |
1,19 |
1,26 |
3,16 |
2,45 |
1,64 |
4,22 |
3,36 |
+13,69 |
+8,85 |
+9,90 |
|
Instituteur gardien ou primaire |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
0,77 |
3,08 |
2,31 |
0,96 |
3,18 |
2,49 |
|
|
|
|
Régent ou agrégé |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
1,72 |
3,26 |
2,62 |
2,27 |
5,46 |
4,30 |
|
|
|
|
Niveau technique supérieur |
1,39 |
1,70 |
1,49 |
1,90 |
4,84 |
2,89 |
3,14 |
5,69 |
4,23 |
+7,69 |
+11,61 |
+9,95 |
|
Type court |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
3,15 |
5,64 |
4,30 |
|
|
|
|
Type long |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
(n.d.) |
3,13 |
10,93 |
3,48 |
|
|
|
|
Niveau universitaire |
0,74 |
1,76 |
0,90 |
1,73 |
4,65 |
2,40 |
2,14 |
5,95 |
3,10 |
+10,14 |
+11,71 |
+11,90 |
|
TOTAL |
1,87 |
3,02 |
2,21 |
3,15 |
11,08 |
5,76 |
7,10 |
17,01 |
10,68 |
+12,89 |
+17,02 |
+15,40 |

Sources : Nos estimations
à partir des données suivantes :
(1) INS : Recensement de
la population au 31/12/1970 - Tome 10 : Niveau d'instruction de la population -
A. Royaume, Provinces, Arrondissements et régions linguistiques, 1976, pp.
168-169.
(2) INS : Annuaire statistique de la Belgique, Tome 105, 1985, pp. 175-177.
(3) INS : Recensement de la population et des logements au 1er mars
1981 - Résultats généraux : population scolaire et niveau d'instruction, n° 4,
1986, pp. 160-166.
Ces constatations
allaient aboutir, progressivement, à une mise en cause radicale du pouvoir
explicatif de la théorie du capital humain et des ses postulats fondamentaux. En
ce qui concerne tout d'abord la relation établie entre l'éducation et la
croissance, l'approche des économistes se complexifia notablement en faisant
intervenir, entre autres, les aspects qualitatifs de l'enseignement et la
diversité structurelle des économies. Dès lors, figer des situations en
recouvrant à des fonctions de production identiques à travers le temps et
l'espace apparaissait comme une simplification excessive rendant la démarche
inopérante. Bien plus, une thèse opposée commença même, au fil des années, à
rencontrer un succès grandissant, à savoir que c'est l'économie qui influe sur
le développement de l'éducation et non l'inverse, ce qui n'est le plus souvent
qu'une autre façon de défendre l'idée selon laquelle l'inadéquation serait le
fait du système scolaire. La volonté manifeste du gouvernement actuel d'étendre
la politique d'austérité au domaine de l'enseignement pourrait s'interpréter
dans ce sens.
Simultanément, le fait
que la poursuite des études supérieures n'apparaisse plus forcément comme une
garantie d'accessibilité à l'emploi, ou à tout le moins aux meilleurs emplois,
amena nombre d'économistes, tant parmi les néoclassiques que parmi leurs
adversaires, à reconsidérer les rapports pouvant exister entre le système
éducatif et le marché de l'emploi. De multiples analyses économiques et
sociologiques du marché du travail démontrèrent en effet que la sélection des
jeunes diplômés à l'embauche ne dépendait pas exclusivement du niveau de
formation atteint mais d'un ensemble complexe de facteurs socio-économiques
discriminant les individus ou les groupes sociaux et cela, dès les premières
orientations scolaires. De plus, ces études révélèrent aussi l'éclatement d'un
marché de l'emploi, jusque là supposé unique, en une série de "segments"
relativement étanches et obéissant chacun à des règles de fonctionnement
particulières. Dès lors, plutôt que de centrer l'analyse sur l'hypothétique
liberté d'arbitrage d'individus parfaitement rationnels qui échapperaient, comme
par enchantement, aux déterminismes que font peser sur eux les structures
sociales et productives, il convenait d'étudier d'abord quels sont les facteurs
discriminants qui conditionnent les aspirations et les comportements des
diplômés confrontés aux mécanismes de sélection et de promotion d'un marché
"segmenté". Cette conception, qui constitue le point de convergence des diverses
"théories de la segmentation du marché du travail" qui se sont développées au
cours des dix dernières années, aboutit évidemment à rejeter l'explication
avancée par la théorie du capital humain et par l'un de ses prolongements, la
théorie du filtre
(19).
En caricaturant un peu, on pourrait dire aujourd'hui que la plupart des
spécialistes doutent qu'un accroissement des dépenses d'éducation créera
systématiquement de l'emploi, ailleurs, bien sûr, que dans le secteur de
l'enseignement. Au contraire, devant la massification du chômage et l'extension
du phénomène de surqualification, il est à craindre que l'on assiste à l'avenir
à une vulnérabilisation croissante de l'ensemble des emplois, y compris de ceux
exigeant les plus hautes qualifications.
Dans ce contexte fort
différent de celui des "golden sixties", les espoirs placés dans le
développement des technologies avancées, et le rôle central que certains
voudraient attribuer en ce domaine au système d'enseignement, se révèlent, sous
bien des aspects, comme une réminiscence de la théorie néo-classique. Une fois
encore, on demanderait en effet à l'éducation d'anticiper l'évolution économique
en produisant aujourd'hui les capacités et les qualifications spécifiques qui
seraient requises dans les branches supposées les plus riches d'avenir puisque,
à terme, les plus productives.

Ainsi, tout en créant les
emplois de demain, l'éducation permettrait de prendre le virage de la nouvelle
révolution industrielle et d'assurer par là le retour à la croissance. Sur le
fond, il est clair que cette conception s'apparente à celle des premiers
promoteurs de la théorie du capital humain, à cette différence essentielle près
que le moyen d'atteindre l'objectif économique passerait désormais moins par
l'élévation du niveau général d'éducation que par l'adaptation des contenus des
formations et la promotion des filières d'enseignement réservées aux élites du
futur. Nous craignons fort, pour notre part, qu'un tel projet de politique
éducative n'apparaisse, à l'expérience, comme une nouvelle utopie. Non seulement
il se heurte aux même critiques que le modèle classique originel, notamment en
ce qui concerne le sens des relations entre éducation, progrès technique et
croissance mais, de plus, il soulève également une série d'objections
particulières :
1. On risque de focaliser
l'attention sur des spécialisations précoces au lieu de favoriser des formations
générales, assorties éventuellement de possibilités ultérieures de recyclages -
alors que le marché de l'emploi demande toujours plus de généralistes, capables
de s'adapter aux changements de situation ou de technique qu'implique
l'accélération du progrès.
2. Les
hyper-spécialisations présentent la propriété de se démoder très vite : diverse
études ont montré que les besoins en techniciens de haut vol diminuent au fur et
à mesure qu'une technologie nouvelle tend à se généraliser, c'est-à-dire à se
banaliser
(20).
Le problème est d'autant plus épineux que la formation est un processus long.
3. On risque aussi de
renforcer la dualité, sur le marché du travail, entre des travailleurs hautement
qualifiés bénéficiant, aussi longtemps que leur qualification est utile, des
emplois les mieux rémunérés et les plus prestigieux, et les travailleurs moins
qualifiés ou non qualifiés qui occuperaient les statuts les plus précaires. Si
l'hyper-spécialisation se fait au détriment de la formation générale, on peut
d'ailleurs craindre que les travailleurs qualifiés d'aujourd'hui deviennent les
sous-qualifiés de demain, généralisant à terme le processus de précarisation,
des emplois tout en divisant artificiellement la classe laborieuse.
4. On peut penser que le
développement de l'éducation, pas seulement technique mais générale (les
mentalités et les attitudes face aux technologies nouvelles ont autant
d'importance, sinon plus que les savoir-faire), est susceptible de créer les
conditions favorables dans le domaine de la recherche, mais :
- ceci suppose que des
moyens soient libérés pour la recherche (problème de politique scientifique);
- et que les résultats de cette recherche trouvent à s'appliquer dans
l'industrie (problème de politique industrielle).

Notes
(1)
Pierre BOURDIEU, Classement, déclassement, reclassement, Actes de la
Recherche en Sciences sociales, n° 24, novembre 1978, pp. 1-22.
(2) Matéo Alaluf et alii. Scènes de chasse à l'emploi.
L'insertion professionnelle des diplômés universitaires. Editions de
l'Université Libre de Bruxelles, 1987.
(3) Jean-Louis CANIEAU et Marcelo OSSANDO. Le spectre du
chômage des jeunes universitaires : nouveau problème, vieilles recettes Cahiers
marxistes.
(4) Michèle RIBOUD et Feliciano HERNANDEZ IGLESIAS. La
théorie du capital humain. Un retour aux Classiques. L'économique retrouvée :
vieilles critiques et nouvelles analyse. Economica, Paris, 1978, pp. 227-247.
(5) Cité d'après M.J BOWMAN. The Human Investement
Revolution in Economic Thought Economics of Education, vol. 1, Ed. par M.
BLAUG; Penguin Modern Economics, 1968, pp. 101-134.
(6) Dans un modèle datant de 1957, Robert SOLOW proposait de
multiplier la fonction de production Cobb-Douglas par un coefficient...P (t)
mesurant le progrès technique accumulé au cours du temps "t". Une version à
peine différente utilisée en 1959 par Odd AUKRUST revenait à adjoindre à cette
même fonction un facteur autonome evt où "v" représentait le taux
d'accroissement annuel du produit imputable au progrès. Cfr. Robert SOLOW
Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and
Statistics, august 1957, pp. 312-320; et Odd AUKRUST Investissement et
expansion économique. Revue de la mesure de la productivité, février 1959,
pp. 39-58.
(7) André PAGE. L'Economie de l'éducation. Collection
SUP, Section "L'économiste", PUF, Paris, 1971, pp. 81-82.
(8) Robert SOLOW fut le premier, en 1962, à envisager ce
type de démarche. Raisonnant toujours à partir d'une fonction de production
Cobb-Douglas, il proposait d'évaluer le stock de capital physique en tenant
compte, simultanément, des générations successives d'équipements en usage chaque
année et d'un taux d'amélioration de la productivité résultant du progrès
incorporé dans les nouvelles machines. Robert SOLOW. Technical Progress, Capital
Formation and Economic Gowth. American Economic Review, Papers and Proceedings,
may1962, pp. 76-86.
(9) Cette démarche fut sans conteste celle qui connut le
plus de succès. Si edward F. Denison en est à la fois le promoteur et le
représentant le plus notoire, ses travaux allaient par la suite inspirer une
foule d'analyses sur les causes de la croissance à travers le monde.
(10) Jean-Louis MAUNOURY. Economie du Savoir, Collection U,
Série "Sciences économiques et gestion", Librairie Armand Colin, Paris, 1972,
pp. 396-397.
(11) Edward F. Denison. The Sources of Economic Growth in
the US and the Alternatives before Us. Supplementary Paper Nb. 13, Commitee for
Economic Development, New York, 1962.
(12) Edward F. Denison. Why Growth Rates Differ : Post-War
Experience in Nine Western Countries. The Brookings Institution, Washington
DC, 1967.
(13) When any expensive machine is erected, the
extaordinary work to be performed by it before it is worn out, is must be
expected, will replace the capital laid out upon it, with at least the ordinary
profits. A man educated at the expense of much labour and time to any of those
employements wich require extraordinary profits. A man educated at the expense
of much labour and time to any of those employements which require extraordinary
dexterity and skil, may be compared to one of those expensive machines. The work
which he learns to perform, it must be expected, over and above the usual wages
of common labour, will replace to him the whole expense of his eduction, with at
least the ordinary profits of an aqually valuable capital. Il must do this too
in a reasonable time, regard being had to the very uncertain durationof humain
life, in teh same manne as the more certain duration of the machine. The
difference between the wages of skilled labour and those of common labour is
founded upon this principle".
Adam Smith. The Wealth of Nations. Bk 1, ch. 10, pt. 1, 1776.
(14) C'est ainsi que l'hypothèse liant l'accroissement de
la productivité du travail à l'élévation du niveau d'éducation de la
main-d'œuvre n'a jamais pu être démontrée. Elle se déduit simplement de la
constatation que les salaires tendent, en moyenne, à augmenter au fur et à
mesure que la formation s'accroît, et de l'hypothèse classique voulant que les
rémunérations soient fixées à la valeur de la productivité marginale du travail.
Il est clair que l'adhésion à ce type de raisonnement relève plus de l'acte de
foi que de la logique pure. D'autre part, lorsque DENISON tient compte des
économies d'échelle comme facteur résiduaire de progrès de la productivité
globale, il se trouve en contradiction avec les hypothèses de base de don
modèle. Celui-ci se fonde en effet implicitaement sur une foncton Cobb-Douglas,
dont l'une des propriétés est de ne pas tenir compte des économies d'échelle.
(15) Jean-Louis MAUNOURY. Op cit, p. 414.
(16) Jean-Claude EICHER. Education et réussite
professionnelle in : J. CL. Eicher, L.LEVY GARBOUA et Alii : Economique de l'Education.
Economica, Paris, 1979, pp. 1-29.
(17) Fondation universitaire, Bureau des Statistiques
Universitaires.
Rapport annuel 1985, pp. XXXIV-XXXVIII.
(18) D’après le Tan Khoi, L’économie de l’éducation,
dans Les sciences sociales de l’éducation. Approches disciplinaires et
planification, Revue internationale de sciences sociales, n°104, UNESCO,
1985, p.244.
(19) La théorie du filtre, qui connut son heure de gloire
au tout début des années septante, avançait que les diplômés étaient embauchés,
non pas en raison de leur niveau de connaissance, mais uniquement parce que le
processus de sélection scolaire ne laissait "filtrer" que les individus les plus
aptes, épargnant ainsi aux employeurs de devoir recourir à des tests et à des
stages probatoires longs et coûteux. A la limite, l'éducation n'avait donc pas
besoin d'ajouter quoi que ce soit à la valeur productive des individus: il
suffisait qu'elle sélectionne ceux présentant le plus d'aptitudes 'naturelles"
pour chaque type d'emploi proposé.
(20) En 1961, James R. Bright constatait déjà que les
compétences requises pour certains emplois industriels commençaient par
s’accroître, pour diminuer ensuite rapidement à mesure qu’augmentait le degré de
mécanisation Ces observations furent largement confirmées par les travaux de
Nelson et alli qui démontrèrent que le niveau moyen d’exigences en matière de
formation tendait à diminuer en même temps que s’accumulait l’expérience des
nouvelles technologies. Cf. James R. Bright. Does Automation Raise Skill
Requirements ?, Harvard Business Review, 1961 ; et Richard Nelson, Merton
Peck, and Edward Kalachek. Technology, Economic Growth, and Public Policy.
The bookings Institution, Washington D.C., 1967.

|